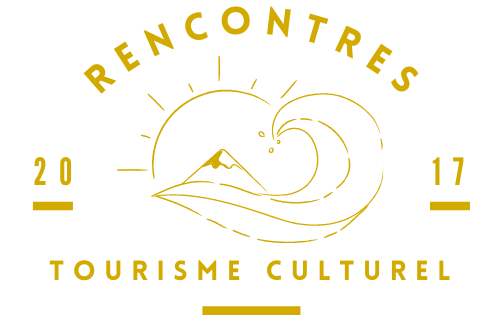C’est le début de la Seconde Guerre mondiale. Deux Allemands vivant en Namibie (alors sous mandat britannique) s’enfuient dans le désert pour échapper à l’internement. Pendant plus de 18 mois, ils vivent une existence à la Robinson Crusoé, s’imprégnant de la beauté amère du paysage lunaire : une immensité de rochers froissés, de dunes de sable, de plaines de gravier et de montagnes au sommet plat. Le duo fabrique même ses propres chaussures, bricolées à partir de vieux pneus et de peaux d’antilope. c’est l’histoire de Le désert refuge (1957), l’un des livres que j’ai lu pour me préparer à mon premier voyage en Namibie.
Le classique négligé de Henno Martin est une histoire incroyable, mais même cela ne m’a pas complètement préparé à l’isolement total de la vie dans le désert et aux différences entre un safari dans le sable et l’observation de la savane à laquelle je suis habitué en Afrique orientale et centrale. Les distinctions me frappent dès mon arrivée à Windhoek, la capitale namibienne. Une ville calme et propre, c’est un monde loin de l’étalement urbain et du chaos qui est le point de départ habituel pour un safari africain.
Je séjourne à la Villa Violet, une maison d’hôtes confortable avec des citronniers dans le jardin. L’influence allemande (la Namibie était une colonie allemande de 1884 à 1915) est omniprésente. Je discute avec Helmut et Antke Halenke, des Allemands septuagénaires qui possédaient une ferme à gibier dans le désert et dont la fille Heidi dirige maintenant la Villa Violet avec son mari. « Nous sommes très forts sur la viande ici en Namibie », déclare Helmut, avant de me parler de son ancienne vie en élevant des animaux pour les chasseurs riches. « Vous devriez essayer l’oryx ou le koudou au Joe’s Beerhouse. »
C’est l’hôtellerie où je vais ce soir-là, un lieu de rencontre populaire pour les jeunes de Windhoek. Mais je ne peux pas tout à fait faire face à manger du gibier le premier jour et me contenter d’un steak de bœuf et d’une ou deux bouteilles de bière blonde Tafel.
Il y a un mélange racial extraordinaire chez Joe’s, mais aucune des tensions que l’on ressent parfois dans l’Afrique du Sud voisine. Cela s’explique en partie par le fait que la Namibie a une petite population (un peu plus de deux millions de personnes), malgré sa masse continentale couvrant presque la même superficie que la France et l’Allemagne réunies.
Le lendemain matin, je m’envole pour le canyon de la rivière Hoanib, le site d’un camp géré par Wilderness Safaris. Introduit à la bourse de Johannesburg en 2010, Wilderness a ouvert de nouveaux lodges dans toute l’Afrique australe et centrale. Hoanib Skeleton Coast Camp est sa dernière entreprise, érigée dans la concession privée Palmwag, une étendue de plus de 400 000 hectares jouxtant le parc national de Skeleton Coast.
En volant là-bas dans un petit Cessna (l’un des avantages de rester avec Wilderness Safaris est qu’il a sa propre mini-compagnie aérienne), je suis frappé par les cicatrices sur le désert ci-dessous : les pattes d’oie et les marques X, les lignes et la fée anneaux sur lesquels glisse l’ombre de l’avion. Des fossettes dans le sable, les anneaux sont un phénomène particulier du désert du Namib que personne n’a encore complètement expliqué.
Certaines lignes sont des routes de gravier, d’autres des lits asséchés de rivières. La majorité des rivières de Namibie sont éphémères et ne coulent qu’une partie de l’année. Parfois, ils ne se remplissent pas d’eau pendant des décennies. Avec d’anciennes formations rocheuses (le Namib est le plus vieux désert du monde), ces cours d’eau intermittents déterminent toute l’écologie de la Skeleton Coast, jusqu’à la frontière angolaise – ma destination finale.
Mais d’abord le Hoanib, dont les eaux coulent encore sous terre, donnant vie aux arbres ana et mopane, et les herbes fines qui poussent le long de ses rives, soutenant une petite population de springboks, girafes, éléphants et lion du désert.
Dès que j’entre dans le camp, je repère des traces de lion. Il s’agit d’une série de sept tentes à deux lits et d’une grande unité familiale, érigées sur des plates-formes en béton lisse. Il y a aussi une salle à manger centrale, un bar et une petite piscine pour la nage en longueur.
Hoanib Skeleton Coast Camp représente le meilleur du nouveau style d’architecture de safari moderniste. Chaque tente dispose d’une chambre en suite avec une terrasse ombragée. De hauts murs de verre reflètent les rouges et les jaunes du désert. Un tissu de couleur kaki, soutenu sur des poteaux et haubané dans le sable avec des câbles d’acier, se gonfle sur des murs intérieurs semi-solides en toile verte.
Dans l’ensemble, c’est une superbe solution : un design en accord avec l’esthétique austère du Namib, qui atténue également la variation de la température du désert. « Ce qui est génial », explique Clément Lawrence, le responsable du camp, « c’est que ces sols en béton retiennent la chaleur du jour pendant la nuit, quand il fait très froid ici – vous verrez ce que je veux dire quand vous reviendrez de votre match. conduire.’
Je suis parti en 4×4, suivant le cours du Hoanib, longeant tantôt ses berges effondrées – hautes de 20 pieds, marquées par des couches sédimentaires couleur rouille – tantôt sur le lit même de la rivière. Les girafes se nourrissent des feuilles vert vif des plantes salvadora et les oryx à longues cornes broutent des gousses d’ana tombées des arbres.
Je passe devant un éléphant, un taureau solitaire, qui soulève de la poussière d’un air maussade. Le vent du désert pousse ses oreilles devant son visage, donnant l’impression de quelqu’un qui se débat sous une couverture grise. Sa colonne vertébrale et ses côtes sont clairement visibles, un effet d’adaptation au désert et de survie sur un tiers de l’eau des éléphants de savane.
Plus tard, je rencontre le grand groupe familial dont il a été expulsé. « Celui-là est un autre jeune fauteur de troubles », dit Arnold Tsaneb, mon guide, en désignant un petit éléphant qui se moque de nous. Finalement, le jeune dur abandonne et essaie de grimper la berge à la place, pliant les genoux de ses pattes avant l’un après l’autre pour faire de petits pas dans le sol.
Le lit de la rivière est dur, marqué de boucles brun foncé de boue séchée provenant du dernier écoulement d’eau souterraine, il y a deux ans. Ressemblant au dessus ébouriffé de la crème glacée Viennetta, il craque lorsque les pneus des quatre roues motrices tournent dessus. Sur le chemin du retour, je repère un chacal à dos noir.
Ce soir-là, après une délicieuse escalope de koudou, je m’assois autour du feu enveloppé dans une couverture. Lawrence avait raison : il fait très, très froid ici la nuit, descendant jusqu’à -3˚C en hiver, qui dure de juin à août. Je me demande comment les renégats allemands de mon livre y ont survécu.
Alors que je retourne à ma tente, la lune au-dessus est jaune, comme si elle aussi faisait partie du désert. J’entends le craquement de mes sandales sur le sable et je m’inquiète des scorpions. Toutes les petites faiblesses humaines y sont exposées, même s’il y a beaucoup moins de danger qu’un safari en Afrique centrale ou orientale.
Le lendemain, je prends un court vol pour Möwe Bay sur la côte. Une station météo abandonnée ici est maintenant un petit musée, rempli d’objets échoués sur la plage. Il y a des ossements de baleine et des crânes de calmar, l’hélice en bois d’un avion, voire la proue sculptée d’un vieux navire, son visage humanoïde piqué et déformé par les effets de ce climat extraordinaire, où au crépuscule un brouillard froid s’élève de l’Atlantique pour se rencontrer la chaleur du désert.
Cela fait bizarre de découvrir une vaste colonie d’otaries à fourrure brune à Möwe. Forts de plusieurs centaines, ils se jettent d’un air grincheux dans les vagues alors que je m’approche. Le rêve du Dr Flip Stander, l’expert en lions à qui je parle cette nuit-là dans le bar du camp de Hoanib, est que cette colonie de phoques redeviendra un jour la proie du dernier groupe de lions sauvages adaptés au désert.
J’avais moi-même vu ces lions rares cet après-midi-là à mon retour de la baie de Möwe, un groupe de quatre mâles et deux femelles se prélassant dans un carré d’herbe. Ils descendent tous d’une seule femelle, la défunte reine du désert (elle est décédée en mai de cette année), ou XPL-10, comme l’appelle scientifiquement Stander.
Barbu, pieds nus, à assez Robinson Crusoé lui-même, Stander a tr
attaquait XPL-10 et ses ancêtres et descendants pendant 30 ans. Il vit à la dure dans un camion spécialement aménagé et festonné d’antennes radio. Il ouvre un compartiment sur le côté pour me montrer un énorme jeu de haut-parleurs qu’il utilise pour appeler les lions, restituant la parade nuptiale et d’autres types de rugissements à partir de fichiers MP3.
« Ces lions sont particulièrement adaptés, non seulement à la vie dans le désert, mais aussi à la vie sur la côte », explique Stander. « Au début des années 80, ils étaient nombreux et ils descendaient régulièrement à la mer. Ensuite, ils ont été presque anéantis, entrant en conflit avec les agriculteurs et les chasseurs locaux. J’étais convaincu qu’ils avaient disparu, mais dans les années 1990, j’ai découvert qu’un petit nombre avait survécu. . . et ce lion, XPL-10, elle était la clé, repeuplant plus ou moins toute la région.’
Il est convaincu que le tourisme a été la principale raison de la survie du lion du désert namibien. « Ils étaient tués dans tous les sens – poison, pièges à gin, tirs – parce qu’ils se heurtaient aux moyens de subsistance des gens », dit-il. « Ce n’est que lorsque le tourisme accorde une plus grande valeur à la terre que l’agriculture que de véritables stratégies de conservation peuvent être développées. »
Vivant de dons individuels, Stander me semble une figure héroïque, quelqu’un qui a donné sa vie à l’étude de ce groupe de lions du désert dans l’espoir que leur résurgence se poursuive. Il dit que la collaboration est cruciale, même avec les chasseurs professionnels qui gèrent des fermes à gibier comme le faisait Helmut Halenke. « La chasse aux trophées existe en Namibie. Cela ne vous plaira peut-être pas, mais c’est le cas, et les éleveurs de gibier aussi ont leur rôle à jouer dans la conservation de cette espèce unique.’
Le lendemain matin, je demande à Lawrence de me faire visiter les installations techniques du camp. « Ici, tout est à l’énergie solaire, me dit-il. « Il y a un générateur, mais nous ne l’allumons que pour vérifier que le bladdy fonctionne toujours. » Je repère deux poubelles en plastique noir au-dessus d’un conteneur d’expédition.
Les couvercles des bacs sont lestés de pierres. ‘Quels sont ces?’ Je demande. « Ach man, ce sont les restes de XPL-10. À sa mort, Flip a apporté son cadavre dans son camion. On la pourrit pour pouvoir mettre son squelette dans le hall. Ça sent très mauvais, n’est-ce pas ?
C’est un sentiment étrange de regarder les poubelles; leur présence souligne la frontière fragile entre la vie et la mort sur ce terrain impitoyable.
Le lendemain, je prends un vol de deux heures vers le nord jusqu’à un autre camp de Wilderness, Serra Cafema. C’est sur les rives de la rivière Kunene, l’un des deux seuls estuaires à débit permanent de Namibie. Ici, il y a de vastes dunes de sable jaune. En arrivant au bord de l’un, en sortant de la piste d’atterrissage, c’est un choc soudain de voir les eaux vertes du Kunene. Ils descendent des forêts tropicales du centre de l’Angola, et le fleuve lui-même sert de frontière entre les deux pays.
Serra Cafema est un délice, un véritable lieu de repos. Son ponton, qui s’étend sur la rivière, est un bon endroit pour déguster un gin tonic. Décoré dans le style classique d’Hemingway, cela me rappelle le Grumeti Tented Camp dans le Serengeti, où une fois j’ai vu le nom de Paul Allen, co-fondateur de Microsoft, dans le livre d’or. Je suis donc ravi de découvrir qu’Allen est allé deux fois à Serra Cafema, réservant tout le camp pour sa famille et ses amis.Je prends un petit bateau à moteur sur le Kunene et j’essaie un peu de pêche, jusqu’à ce que les très gros crocodiles me fassent peur se prélasser sur les berges. Je suis à quelques mètres d’un de ces énormes individus, apparemment endormis, lorsqu’il se jette dans l’eau sous le bateau. J’ai failli tomber de peur alors que le guide tire sur le moteur. Nous nous retrouvons bientôt de l’autre côté de la rivière, heurtant la rive, poussant l’Angola.
Le lendemain matin, je visite un campement du peuple Himba local, l’une des dernières véritables tribus nomades sur terre. Ils mènent une existence nue dans des huttes en forme de dôme et couvertes de fumier dans le désert. Le seul signe de richesse dans leur vie est la façon dont les femmes se couvrent le corps de terre rouge et tressent leurs cheveux dans des arrangements élaborés de cuir, de boue et de touffes de queues d’oryx.
Cet après-midi-là, je roule en quad à travers les dunes. Je n’aurais jamais pensé que ce serait mon truc, accélérer sur le sable comme ça, mais c’est grisant. Je continue jusqu’à la tombée de la nuit, redescendant dans l’obscurité vers les chaudes lumières jaunes de la Serra Cafema, un refuge heureux où moi aussi j’espère retourner un jour. Ce ne sont pas seulement les Allemands fuyant les Britanniques, et les lions du désert fuyant les humains en général, que cet étrange paysage spartiate peut abriter.
S’y rendre
Voyage Afrique (+44 20 7843 3500 ; www.africatravel.co.uk) propose un safari namibien de sept nuits à partir de 4 385 £ par personne, y compris les vols aller-retour de British Airways vers Windhoek, une nuit en pension complète à la Villa Violet, trois nuits à la fois au Camps Hoanib Skeleton Coast et Serra Cafema, avec tous les repas, boissons et activités sélectionnées, et transferts
Cette fonctionnalité est apparue pour la première fois dans Condé Nast Traveler novembre 2014
★★★★★